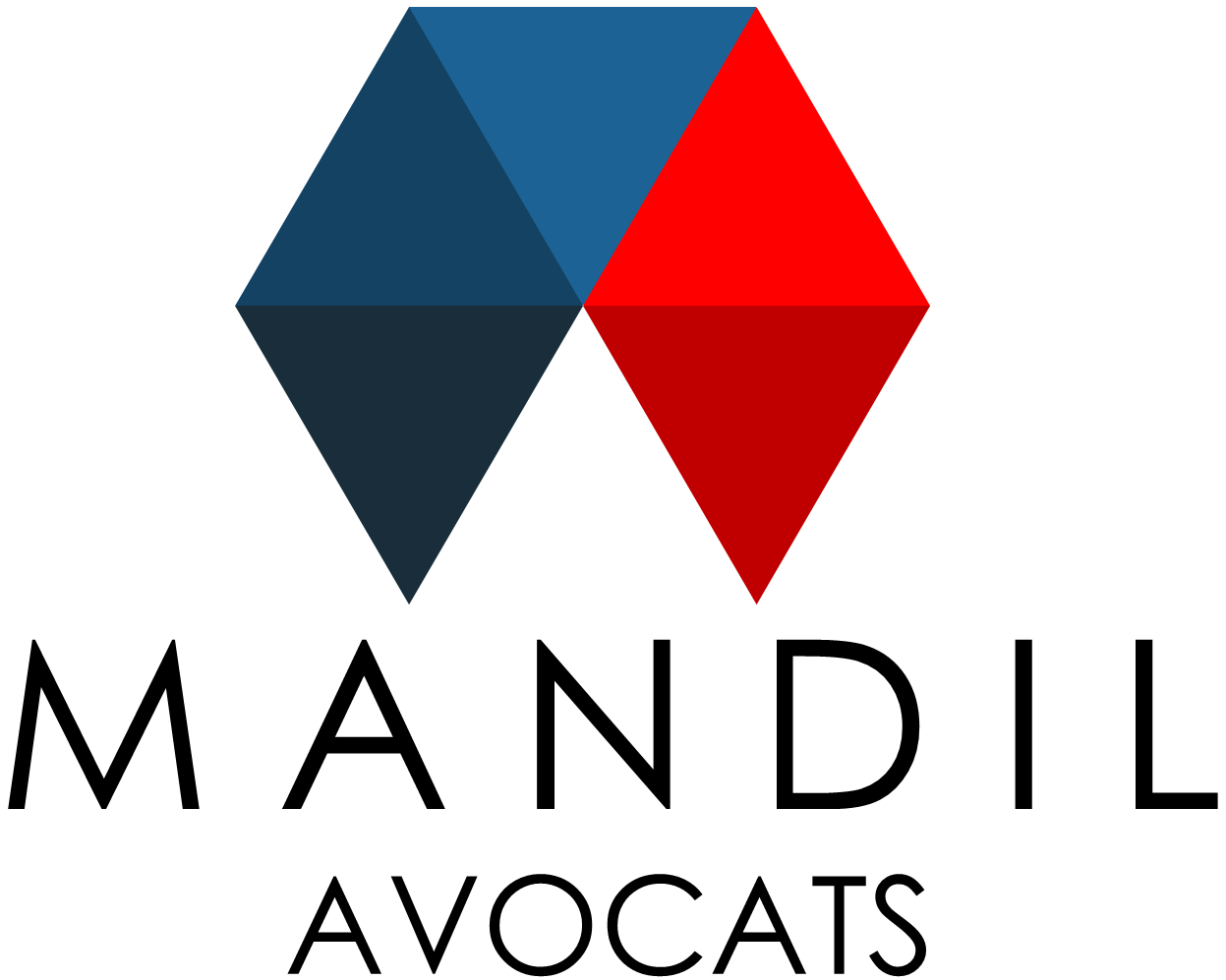Le 28 janvier 2016, la commission juridique du Parlement européen a entériné une version ultime de la directive européenne destinée à protéger le secret des affaires des entreprises européennes[1]. Fruit de longues tractations (plus de 300 amendements déposés) entre les représentants du Parlement européen et du Conseil de l’UE, le texte avait été obtenu le 15 décembre 2015. Cette directive, fortement contestée, illustre la difficulté que représente la recherche d’un compromis entre liberté d’information et protection du secret des affaires[2].
S’il est mentionné dans de nombreux codes (du commerce, de la consommation, des postes et télécommunications électroniques ou encore dans le code monétaire et financier), le secret des affaires ne fait l’objet d’aucune définition légale. Il peut néanmoins être défini comme l’ensemble des informations licites et confidentielles dont la divulgation causerait un préjudice à leur détenteur légitime. Sont visés, le savoir-faire, mais également toutes informations stratégiques, qu’elles soient technologiques ou commerciales.
Or, force est de constater que la connaissance constitue de nos jours la clé de l’innovation et de la croissance économique. Depuis l’essor du numérique dans les années 2000 et dans cette guerre économique que se livrent les différents acteurs économiques mondiaux, le patrimoine des entreprises prend de plus en plus la forme d’informations dématérialisées, vulnérables et faciles à dérober. L’espionnage industriel est, de fait, en progression constante. De même, des instruments légaux accroissent le risque de soustraction d’informations stratégiques :
- D’une part, il est fréquent que la transparence prenne le pas sur le secret des affaires. En effet, de nombreuses obligations d’information pèsent sur les sociétés. Certaines personnes (salariés, actionnaires…) disposent également de droits à l’information sur la conduite des affaires sociales. De même, les sociétés cotées ont l’obligation de porter à la connaissance du public toutes les informations pertinentes (comptables, financières…) susceptibles d’influencer le cours de l’action. Il en découle une prohibition de l’usage d’informations privilégiées et de la diffusion de fausses informations, limitant, de ce fait, la protection du secret des affaires et les possibilités de mener des guerres de l’information. Ces obligations sont trouvent toutefois leur légitimité dans la nécessité de protéger investisseurs et épargnants.
- D’autres parts, avant même les écoutes téléphoniques et les révélations de Snowden au sujet de la NSA, les Anglo-saxons ont instauré des instruments légaux leur permettant d’obtenir des informations sur des entreprises étrangères. En effet, considérée indispensable à la recherche de preuves, la procédure dite de Discovery est une phase d’investigation préalable au procès civil ou commercial, quasi systématique aux États-Unis et dans les autres pays de Common Law. Chaque partie se voit ainsi dans l’obligation de divulguer toute information susceptible de faciliter l’établissement de preuves[3]. Elle fait pourtant l’objet de vives critiques dans les pays de tradition civiliste en raison des excès auxquels elle a pu donner lieu à l’égard des entreprises européennes filiales de sociétés américaines, ou qui ont une activité outre-Atlantique.
Toutefois, comme le répètent depuis de nombreuses années les acteurs de l’Intelligence économiques et les industriels, le droit français compte parmi les moins protecteurs des « renseignements non divulgués ». Ceci, en dépit des engagements conventionnels souscrits en ce sens (article 39.2 du texte de l’accord sur les Adpic[4]). Des nations comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Allemagne ont d’ores et déjà offert à leurs entreprises une législation plus adaptée au phénomène du pillage.
Il est vrai qu’en France, la protection légitime du secret des affaires est aussi placée à l’épreuve du droit à l’information du public, soutenu par la liberté d’expression journalistique. C’est donc en sécurisant celle-ci que la protection indirecte dont bénéficie pour l’heure le secret d’affaires pourrait être utilement relayée par un mécanisme de protection directe.
I. L’efficacité limitée de la protection indirecte du secret des affaires
Les entreprises françaises disposent actuellement de plusieurs dispositifs légaux destinés à protéger leurs secrets, que ce soit la loi sur la contrefaçon, la loi sur la fraude informatique, ou encore la protection des secrets de fabrique… Toutefois, trop complexes, ces outils juridiques mobilisés pour protéger les informations stratégiques des entreprises paraissent insuffisants, qu’il s’agisse des infractions pénales jugées inadaptées, ou de l’action en concurrence déloyale perçue comme peu dissuasive.
A. Les incriminations du droit commun des biens inadaptés
Prévues dans le droit positif français, les incriminations du droit commun des biens apparaissent peu adaptées à la répression de l’atteinte a des données confidentielles d’une entreprise en raison de la nature incorporelle de l’objet sur lequel elle porte.
- Ainsi, le principal obstacle à la répression du vol d’information tient à l’exigence d’un acte de soustraction. Il convient toutefois de mentionner une décision isolée lors de laquelle les juges du fond ont pu considérer que le transfert d’informations aux fins d’actualisation de fichiers antérieurs était constitutif de soustraction frauduleuse, reconnaissant ainsi le vol de données informatiques[5]. On citera également un célèbre arrêt du 20 mai 2015 de la Cour de cassation[6] (affaire Bluetouff) confirmant une condamnation pour maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, mais surtout de vol de fichiers informatiques[7].
- Par ailleurs, les articles 323-1 à 323-7 du Code pénal répriment toute atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données[8]. Ainsi, le fait d’accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30000 euros d’amende.
- De plus, la qualification d’abus de confiance, prévue par l’article 314-1 du Code pénal[9], peut s’appliquer au dénouement de clientèle au profit d’une société concurrente. Néanmoins ce fondement suppose que l’information détournée ait été préalablement remise à l’auteur de l’infraction « pour un usage déterminé ».
- Le délit de violation du secret de fabrique prévu par l’article L.621-l du Code de la propriété intellectuelle[10] sanctionne, quant à lui, la révélation à un tiers d’une information portant sur un procédé technique industriel gardé secret. La protection ne concerne toutefois que les employés de l’entreprise et non les tiers qui s’approprieraient frauduleusement l’information. De quoi, toutefois, lutter contre le « syndrome de la stagiaire chinoise ».
- Enfin, les articles 226-13 et 226-14 du Code pénal[11] protègent le secret professionnel. En effet, « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende».
Néanmoins, qu’il s’agisse de l’abus de confiance, de l’escroquerie[12], de l’intrusion dans un système de traitement automatisé de données, du secret de fabrique ou du secret professionnel, il ne s’agit là que de moyens de réponse parcellaires et difficiles à mettre en œuvre, ce que confirme la jurisprudence souvent peu respectueuse de la confidentialité économique. Il est ainsi frappant de constater que le secret des affaires ne fait pas partie des exceptions justifiant que les audiences se déroulent en chambre du conseil (non publiques).
B. Les actions en concurrence déloyale peu dissuasives
Sur le plan civil, et plus particulièrement en matière de concurrence, le secret des affaires revêt une certaine importance.
L’article L. 420-1 du code de commerce[13] a, par exemple, pour objectif de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles telles que les ententes sur les prix ou les abus de position dominante. Sont ainsi prohibées les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, lorsqu’elles ont pour objet où peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché.
La société victime d’une atteinte au secret des affaires peut agir sur le fondement de l’action en concurrence déloyale[14], eu égard à la désorganisation interne de l’entreprise par voie de détournement de fichiers ou de débauchage de salariés. L’action en concurrence déloyale a pour but de demander aux tribunaux d’accorder à la victime des dommages et intérêts pour réparer le préjudice et la cessation rapide du trouble causé. Elle suppose d’apporter la preuve de l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. L’action peut être exercée contre un ancien salarié exploitant un savoir-faire acquit à la faveur d’un contrat de travail, qu’il l’utilise pour lui-même ou le mette à la disposition d’un employeur concurrent. Elle peut aussi être exercée contre le nouvel employeur qui s’est livré à un espionnage commercial. La protection du secret est d’autant mieux assurée que le récipiendaire de l’information protégée est tenu contractuellement de ne pas la divulguer à autrui, ce qui est le cas dans un accord de transfert de technologie.
Si le choix de la voie civile parait mieux adapté au contexte concurrentiel, l’effet dissuasif reste mince, à défaut d’une juste proportion entre la réparation et l’avantage acquis. En pratique, le préjudice concurrentiel est difficile à évaluer. Dans une affaire déjà ancienne, celui-ci a pu résulter de la « diminution importante de la valeur patrimoniale du savoir-faire essentiel de la société victime ». En tout état de cause, la protection du savoir-faire est rarement mise à l’épreuve de la pratique judiciaire, la seule divulgation en justice suffisant à annihiler sa valeur. Dans une tribune commune, Jean-Marie Garinot, maître de conférences à l’université de Bourgogne et Geoffroy Canivet, avocat au barreau de Paris affirmaient que « si les tribunaux ont réussi, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, à assurer une certaine protection contre la concurrence déloyale, elle n’est accessible qu’à ceux qui ont l’expertise nécessaire, ou les moyens de s’offrir l’expertise nécessaire à sa mise en œuvre, ce qui n’est pas le cas des innovateurs les plus fragiles, des entrepreneurs individuels et des petites entreprises, qui sont pourtant l’un des tissus les plus féconds de l’innovation[15] ».
Enfin, en matière de procédure, l’article L. 463-4 du Code de commerce[16] prévoit une limitation de la communication ou de la consultation de certains documents mettant en jeu le secret des affaires. L’article dispose que « sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d’une partie mise en cause, le rapporteur général de l’Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles ». En effet, sous l’influence du droit communautaire, le droit processuel de la concurrence a progressivement élaboré un régime de traitement confidentiel des secrets d’affaires pour éviter que les renseignements confidentiels recueillis par l’Autorité de la concurrence en charge de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles ne soient transmis aux autres parties à la procédure.
Notons que dans une récente affaire (Cass. Com., 19 janv. 2016), la Cour de cassation a rappelé que « le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l’Autorité n’est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection de leurs affaires ».
Précisons enfin que si les dispositifs tels que les accords de confidentialité ou les outils offerts par le droit de la propriété intellectuelle ont le mérite d’exister, ils ne constituent qu’un faible instrument susceptible de dissuader les fraudeurs. Eu égard à l’insuffisance des outils juridiques actuels, la consécration d’une protection septique du secret des affaires présenterait donc une utilité incontestable.
II. L’émergence contrariée d’une protection directe du secret des affaires sur le plan interne
Cette consécration d’une protection spécifique du secret des affaires est, à l’heure actuelle, différée, faute d’une sécurisation de la liberté d’expression des formalistes et lanceurs d’alerte.
A. Les contours proposes d ’une protection specifique
Plusieurs textes ont tenté, sans succès, de protéger efficacement le secret des affaires. En 2009, le haut responsable à l’intelligence économique de l’époque, Alain Juillet, avait confié à Claude Mathon, avocat général à la Cour de cassation, le soin de rédiger un rapport sur la protection du secret des affaires[17].
Entre 2010 et 2012, l’ancien député Bernard Carayon fut l’auteur de plusieurs propositions de loi visant à sanctionner la violation du secret des affaires en introduisant le délit de « violation du secret des affaires ». Le dernier texte instaurait une sanction de trois ans de prison et de 375 000 euros d’amende dans le droit français,[18] mais ne fut toutefois jamais voté au Sénat. En juillet 2014, les socialistes Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas tentèrent, eux aussi, de faire passer une proposition de loi en ce sens,[19] s’inspirant d’une proposition de directive de la Commission européenne destinée à protéger les savoir-faire et informations commerciales non divulgués, elle-même inspirée du Uniform Trade Secret Act (UTSA) américain.
C’est finalement dans le projet de loi Macron qu’avait été insérée par voie d’amendement la proposition de loi déposée en juillet 2014. Adoptés en commission le 17 janvier 2015, les amendements visaient à insérer dans le livre premier du Code de commerce un titre V intitulé « du secret des affaires ». Un amendement prévoyait également des modifications de la loi du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents à des personnes étrangères, dite loi de blocage[20].
- Ces amendements entendaient introduire dans le droit français un outil juridique permettant aux entreprises françaises de bénéficier des armes face à la menace de l’espionnage industriel dont les cibles privilégiées sont la recherche fondamentale, l’aéronautique, la Défense et la santé.
- Le texte définissait également le secret d’affaires comme étant toute information, inconnue au sein d’un milieu professionnel, et faisant l’objet de mesures de protection raisonnables, compte tenu de sa valeur économique, pour en conserver le caractère non public[21].
- En outre, le texte sanctionnait toutes les atteintes au secret (révélation sans autorisation, détournement…) en intégrant à notre droit positif un nouveau délit civil et une infraction pénale, punie de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende. La peine pouvait monter à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende en cas d’atteinte « à la sécurité ou aux intérêts économiques essentiels de la France ».
- Au plan civil, afin de faire cesser l’atteinte au secret, une procédure inspirée de la propriété intellectuelle aurait permis de solliciter des mesures conservatoires et provisoires, telles que l’interdiction d’usage ou la saisie des produits présumés en infraction.
- Enfin, le texte prévoyait des aménagements d’ordre procédural, relatifs aux modalités de transmission des pièces ou à la publicité des débats, destinées à conserver secrètes les informations économiques non divulguées évoquées par les parties dans le cadre des procédures judiciaires.
B. La sécurisation incertaine de la liberté d’information
Ce texte visant à protéger le secret des affaires fut rapidement contesté, de nombreux journalistes (l’Association de la presse judiciaire par exemple) et ONG y voyant un moyen offert aux entreprises pour dissimuler des agissements prohibés ou inavouables. Ces derniers considéraient que si le texte prévoyait l’inopposable du secret à celui qui signale aux autorités compétentes des faits illicites, il ne permettait pas la révélation de pratiques contestables sans être délictuelles dont il est essentiel que le public soit informé. Hors infraction, la capacité d’informer des journalistes était donc limitée par l’appréciation que ferait le juge de donner une information. Selon Christophe Bigot, avocat spécialisé dans le droit de la presse, affirmait avant que le texte soit repoussé : « c’est au juge de décider de la pertinence d’informer ; faudra-t-il se contenter de dire qu’il y a un plan social dans une entreprise ou peut-on aller jusqu’à donner le nombre d’emplois visés ? Cela risque d’être très arbitraire. En l’état, le journaliste économique est mis sous étroite surveillance. »[22] Il précisait également que parler de « secret des affaires » est très restrictif et que c’était « toute l’information économique et sociale qui est mise en danger ».
De même, Charles Morel, avocat spécialisé dans le droit de la presse indiquait en janvier 2015 dans une interview accordée à Challenge[23] que le texte aurait eu comme principal effet d’intimider tous ceux (lanceurs d’alertes, blogueurs, journalistes) ayant vocation à informer le public. Il aurait suffi aux entreprises de brandir la menace d’un dépôt de plainte pour « violation du secret des affaires ».
En outre, la protection du secret des affaires mise en œuvre par ce texte était accusée de ne pas parvenir à instaurer un équilibre, voire même de créer un déséquilibre, entre la protection des entreprises et la protection des sources des journalistes, contrairement à certaines autres puissances. A titre d’exemple, si les entreprises américaines bénéficient depuis longtemps d’une législation protectrice dans ce domaine (le Cohen Act), les États-Unis bénéficient en retour d’un 1er amendement qui interdit au Congrès d’adopter des lois limitant la liberté de religion et d’expression, la liberté de la presse ainsi que d’une législation (le Whistleblower Protection Act) plusieurs fois renforcée protégeant les lanceurs d’alerte.
Le texte laissait aussi subsister la menace de la saisie ou du séquestre des exemplaires d’un journal faisant part d’un secret d’affaires. En effet, le projet de loi écartait la responsabilité du journaliste ou du lanceur d’alerte, mais n’empêchait pas le détenteur du secret de demander au tribunal d’ordonner toute mesure de nature à faire cesser l’atteinte.
Ces contestations s’appuyaient également sur le droit européen des droits de l’homme en arguant que malgré le projet de directive, la jurisprudence européenne reste particulièrement protectrice des journalistes et des informateurs[24]. La Cour européenne des droits de l’homme se refuse par exemple à distinguer parmi les informations celles qui revêtiraient un intérêt public et les autres. Ainsi, dans la célèbre affaire Goodwin[25], la Cour considère que « l’intérêt public de ces informations ne pourrait servir de critère pour juger de l’existence d’un besoin social impérieux poussant à ordonner la divulgation de la source ».
Précisons que le député socialiste Yann Galut a déposé en décembre 2015, en partenariat avec Transparency Internatiobnal[26], une proposition de loi visant à garantir une meilleure protection aux lanceurs d’alerte. Il entend créer une « Agence nationale de l’alerte » confiée à des magistrats et des représentants du Parlement[27].
C. Des craintes pour le droit à l’information non justifiées ?
Si la contestation de ces amendements a été forte, il n’en demeure pas moins que le texte intégrait des exemptions destinées à garantir la protection des journalistes et des lanceurs d’alerte.
- L’article L 151-2 intégrait ainsi la notion de « liberté d’expression ou d’information» et prévoyait que « toute atteinte, délibérée ou par imprudence, au secret des affaires prévues aux deux premiers alinéas du présent article engage la responsabilité civile de son auteur, à moins qu’elle n’ait été strictement nécessaire à la sauvegarde d’un intérêt supérieur, tel que l’exercice légitime de la liberté d’expression ou d’information ou la révélation d’un acte illégal ». Il est donc peu probable que cette notion de « sauvegarde d’un intérêt supérieur » n’eut pu trouver à s’appliquer aux informations révélées dans le cadre des affaires Médiator, PIP ou encore Luxleaks.
- En outre, l’article L. 152-2 précisait que le secret des affaires n’était pas opposable « dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret », ou garantissant ainsi à la fois l’effectivité des protections existantes (telles que les lois adoptées entre 2007 et 2013 protégeant les lanceurs d’alerte) et la liberté d’action des institutions représentatives du personnel. Ce même article précisait également que le secret n’est pas non plus opposable à « celui qui informe ou signale aux autorités compétentes des faits susceptibles de constituer des infractions aux lois et règlements en vigueur dont il a eu connaissance»[28].
Par conséquent, force est de constater que ce texte avait le mérite de tenter d’assurer le difficile équilibre entre la protection des secrets d’affaires et la liberté d’expression et d’information du public. Entre la sauvegarde des libertés fondamentales et celle des informations stratégiques de nos entreprises.
Il n’en demeure pas moins que la coalition de journalistes et d’ONG eut finalement raison du texte. Les amendements votés le 17 janvier 2015 furent écartés par le gouvernement le 30 janvier 2015)[29].
Néanmoins, une consécration de la protection du secret des affaires pourrait intervenir rapidement au niveau européen, la France n’ayant alors d’autre choix que d’en assurer la transposition.
III. Une directive européenne comme ultime chance pour protéger le secret des affaires de nos entreprises ?
En effet, la Commission européenne avait présenté en 2013 une proposition de directive sur le sujet[30]. Contrairement au texte français de 2014 qui privilégiait la voie commerciale, la directive, dont le cadre général a été adopté par le Conseil de l’Union européenne le 26 mai 2014, aborde la question sous l’angle de la propriété intellectuelle. Dans son exposé des motifs, la directive indique notamment que « les droits de propriété intellectuelle (DPI) constituent une part essentielle d’une politique d’innovation. Les DPI donnent aux innovateurs et aux créateurs les moyens de s’approprier les résultats de leurs travaux, immatériels par nature, ce qui représente l’incitation nécessaire pour des investissements dans de nouveaux savoir-faire, solutions et inventions. Les DPI tendent à protéger les résultats d’efforts créatifs ou inventifs, mais leur couverture est limitée. » En effet, durant toute la phase de recherche et de création, une quantité importante d’informations est compilée. Ces informations ne peuvent pas faire l’objet d’une protection par les droits de la propriété intellectuelle, tout en étant aussi importantes pour l’innovation et pour la compétitivité des entreprises. Ces pourquoi la confidentialité constitue le plus souvent l’alternative choisie afin de permettre à la propriété intellectuelle de fructifier et de déboucher sur des innovations. Tout DPI commence ainsi par un secret : c’est le «secret d’affaires».
Or, selon la Commission, en 2013, une entreprise européenne sur quatre aurait fait état d’au moins un cas de vol d’informations, contre 18 % en 2012[31]. La Commission européenne prend ainsi toute l’ampleur de la nécessité de protéger les données sensibles de nos entreprises en améliorant la capacité des victimes à se défendre en justice avec des voies de recours suffisantes et à obtenir une juste réparation. Des millions d’emplois dépendent, en effet, d’informations techniques, de procédés de fabrications, de recettes, d’informations commerciales ou de composés chimiques[32]. La Commission européenne reconnait par ailleurs que «la confidentialité est un outil de compétitivité » et que «les secrets d’affaires peuvent être vecteurs de croissance économique et d’emplois».
La directive se donne, dès lors, pour objectifs d’harmoniser la notion de secret d’affaires en Europe, de faire converger leurs différentes législations et également de mieux protéger les entreprises européennes contre l’espionnage industriel et la concurrence déloyale. Définissant l’objet de la directive, l’article 1 dispose que « La présente directive établit des règles protégeant les secrets d’affaires contre l’obtention, la divulgation et l’utilisation illicites » et propose une définition du secret des affaires à son article 2[33].
La directive prévoit ensuite que les États membres s’assurent que les détenteurs de secrets d’affaires aient le droit de demander les mesures, procédures et réparations afin d’empêcher l’obtention, l’utilisation ou la divulgation illicite d’un secret d’affaires ou d’obtenir réparation pour un tel fait. Elle prévoit ensuite différents recours civils, différentes sanctions et demande aux États de veiller à assurer la protection du caractère confidentiel des secrets d’affaires au cours des procédures judiciaires (article 8). En outre, des mesures provisoires et conservatoires sont également prévues pour faire cesser toute atteinte au secret des affaires et la directive préconise d’assurer une réparation effective des dommages pouvant résulter d’une violation du secret.
Toutefois, une fois encore, ce texte a dû faire face à un important mouvement de contestation. La principale critique concerne le champ d’application de cette directive, jugé beaucoup trop large. En effet, si dans son l’article 4 la directive exclut de son champ d’application « l’usage légitime du droit à la liberté d’expression et d’information » et « la révélation d’une faute, d’une malversation ou d’une activité illégale du requérant », les opposants jugent ces exemptions trop floues[34].
Ainsi, de nombreuses initiatives ont été prises pour alerter sur ces dangers, et notamment un appel européen intitulé « Stop Trade Secrets » signé par 67 organisations issues de 11 pays européens. De plus, dans une pétition (plus de 492 000 signatures), la célèbre journaliste d’investigation, Élise Lucet, affirmait qu’avec la directive le grand public n’aurait jamais entendu parler du scandale financier de Luxleaks, des pesticides de Monsanto ou encore du scandale du vaccin Gardasil. Elle précise que « si une source ou un journaliste ‘viole’ ce secret des affaires, des sommes colossales pourraient lui être réclamées, pouvant atteindre des millions voire des milliards d’euros, puisqu’il faudra que les ‘dommages-intérêts correspondent au préjudice que celui-ci a réellement subi’. On pourrait même assister à des peines de prison dans certains pays. »[35]
D’autres, parmi lesquels Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, indiquent que « les fameuses ‘données à caractère commercial’ qui seraient protégées par le secret des affaires, et dont la divulgation serait passible de sanctions pénales, relèvent très souvent de l’intérêt général supérieur pour le public. Ce fut le cas, par exemple, pour les montages fiscaux et financiers négociés entre plusieurs grands groupes et l’administration fiscale du Luxembourg, ou pour les données d’intérêt général relatives à la santé publique, ou encore pour celles liées à la protection de l’environnement et à la santé des consommateurs dans le secteur de l’industrie chimique et qui seraient dans leur globalité considérées comme secrètes, et soustraites ainsi à toute transparence »[36].
En outre, des opposants s’inquiètent également des restrictions à la mobilité des salariés. Ils indiquent que « le Conseil européen propose notamment de permettre aux entreprises de poursuivre leurs salariés devant les tribunaux pendant 6 ans, ce qui revient à leur imposer des clauses de non-concurrence les empêchant d’utiliser leur savoir-faire auprès de leur nouvel employeur »[37].
Il est, par ailleurs, surprenant de constater que l’Assemblée nationale, qui avait adopté les amendements de la loi Macron relatifs au secret des affaires en janvier 2015 a adopté en juin 2015 une proposition de résolution européenne sur la proposition de directive[38] dans laquelle elle proclame que « la protection du secret des affaires ne doit pas restreindre la liberté des travailleurs».
C’est pourquoi, après négociations entre le Parlement et les États membres, la directive a fait l’objet de plusieurs amendements. La version finale du texte adopté le 28 janvier 2016 par la commission des affaires juridiques du Parlement européen semble avoir pris en compte les inquiétudes des médias en actant la suppression du terme « légitime », pour qualifier les informations que la presse peut ou non, diffuser sur une entreprise. En effet, selon de nombreux journalistes, cette formulation les aurait forcés à devoir justifier du bien-fondé de leurs révélations rendant plus aisé les procédures judiciaires à l’encontre de la presse. Dorénavant, il semble que les seules limitations au travail de la presse prévue par la future directive sont celles qui existent déjà dans la charte des droits fondamentaux (notion d’intérêt général) à laquelle la directive fait référence. La Fédération européenne des journalistes s’est déclarée « globalement satisfaite des amendements votés » tout en appelant à la création d’une protection légale pour les lanceurs d’alerte.
Le scrutin en plénière au Parlement européen ne devrait pas avoir lieu avant mars[39]. Il ne reste, dès lors, plus qu’à espérer que la transposition de cette future directive dans notre droit national soit à la hauteur des enjeux et ne fasse pas, une nouvelle fois, l’objet de fantasmes qui empêchent à nos entreprises de disposer, dans la guerre économique mondiale, des armes dont elles ont besoin. À défaut, les principales victimes de ces lacunes demeureront nos PME-PMI innovantes, sources d’emplois et de croissance.
Alexandre Mandil